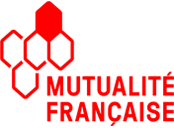Plus de la moitié des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans vivant à domicile (54%), déclarent un mauvais ou un très mauvais état de santé en 2022, contre 7 % dans l’ensemble de la population. Ainsi, neuf personnes handicapées sur dix souffrent d’une maladie chronique, soit trois fois plus que les autres patients. Interrogées sur leur recours aux soins, les personnes handicapées expriment plus souvent un besoin de soins mais, paradoxalement, elles sont plus nombreuses à y renoncer.
Ces données sont extraites du panorama Le handicap en chiffres, publié fin novembre 2024 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees). La dernière édition de cet ouvrage annuel dresse un constat inquiétant de l’état de santé des handicapés en France, alors que la loi dite « handicap » fête ses vingt ans.
Une loi ambitieuse
Le 11 février 2005, la France s’est en effet dotée d’une loi ambitieuse pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Présentée comme une avancée majeure dans la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, cette loi a instauré une palette de mesures pour favoriser leur autonomie et leur inclusion à tous les niveaux : éducation, emploi, citoyenneté, services de santé, etc. Le texte s’appuie sur deux principes fondamentaux : l’accessibilité universelle et la compensation du handicap.
Vingt ans plus tard, on est assez loin de l’objectif d’« accessibilité à tout pour tous » qu’imposait la loi, notamment aux établissements recevant du public parmi lesquels les établissements de santé.
Manque d’accessibilité
Dans une décision rendue publique le 17 avril 2023, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l’Europe a conclu à une violation par la France de la Charte sociale européenne. En cause : l’absence de mesures efficaces pour remédier, entre autres, aux problèmes d’accès des personnes handicapées aux services de santé. Globalement, le Comité pointait la pénurie de services d’aide, le manque d’accessibilité des bâtiments et des installations, concluant donc à un manque de protection de la famille.
Hébergé sur le site de l’Assurance maladie, le baromètre national Handifaction évalue régulièrement l’accès aux soins des personnes vivant avec un handicap, à l’aide d’un questionnaire complété par les usagers concernés et/ou leurs aidants (https://www.handifaction.fr/barometre/). Au dernier trimestre 2024, 25% des répondants à l’échelon national ont déclaré n’avoir « pas pu accéder aux soins dont ils avaient besoin », rapporte ce baromètre. Même s’il varie sensiblement d’une région à l’autre – de 19% dans le Grand Est à 32% en région Centre Val de Loire –, ce taux d’inaccessibilité aux soins des personnes en situation de handicap témoigne d’un problème persistant malgré l’instauration de la loi de 2005.
Plus grave : 18% des répondants indiquent avoir « subi un refus de soin » ayant ensuite conduit une personne sur quatre à abandonner leur démarche. Les médecins spécialistes en ville concentrent 45% des difficultés d’accès aux soins recensées, les services hospitaliers 18% et les médecins généralistes 16%, précise le baromètre.
« Il n’y a pas d’ascenseur… »
« C’est parfois compliqué de trouver un médecin quand on est sur ses deux jambes. Mais trouver un professionnel de santé pour notre fille en fauteuil roulant, ça l’est encore plus ! », déplore Etienne Thierry, journaliste à Angers, papa de Luce, une jeune fille de 12 ans infirme moteur cérébrale, en fauteuil depuis l’âge de 5 ans, et scolarisée en milieu ordinaire avec un accompagnement.
« Sur Doctolib, où s’effectuent 80% des prises de rendez-vous médicaux, les professionnels de santé n’indiquent pas tous si leur cabinet est accessible, alors que ça devrait être la norme. Du coup, pour les rendez-vous de Luce, il faut appeler pour demander si c’est "accessible", témoigne-t-il. Et parfois, quand on nous répond "oui, oui, pas de problème, c’est de plain-pied", on découvre une fois sur place que la machine nécessaire à l’examen de notre fille est au premier étage et qu’il n’y a pas d’ascenseur... »
Une situation courante qui pousse souvent les handicapés et leurs pairs aidants vers les structures hospitalières, installées en périphérie des villes, souvent dans des bâtiments récents et accessibles à tous, plutôt que chez les professionnels libéraux en ville. En outre, ces établissements multidisciplinaires offrent un suivi médical coordonné entre les spécialités (kinésithérapie, ergothérapie, psychiatrie/psychologie…) bien utile pour de nombreux handicapés. « Malheureusement, ces structures ont des plages de consultation limitées à la journée du fait de l’activité salariée de leurs personnels. Chez un praticien libéral, on peut obtenir un rendez-vous à 18h30 ou à 19h, après l’école ou le travail », tempère Etienne Thierry.
Former davantage les personnels soignants
Corollaire de l’accès aux soins, la formation – des personnels soignants notamment – constituait l’un des axes de la loi de 2005. Mais les campagnes de sensibilisation et les formations destinées aux employeurs, enseignants et surtout aux professionnels de santé, demeurent timides et peinent à répandre une véritable culture de l’inclusion.
Dans certaines facultés de médecine, les étudiants ont la possibilité, durant leur formation, de voir le quotidien d’une personne handicapée et de sa famille. « Plusieurs fois par an, on accueille des étudiants durant une demi-journée, le mercredi, explique Etienne. On déjeune ensemble. Après, on va à la kiné et on leur fait faire un tour de ville pour leur montrer les problèmes d’accessibilité au quotidien. » Cela permet de faire passer quelques messages sur le handicap et l’inclusion, afin de sensibiliser ces médecins en devenir. Dommage que ces courtes immersions dans le quotidien des handicapés ne fassent pas partie du socle obligatoire de connaissances des étudiants en médecine, proposées aujourd’hui sur la base du volontariat.
Rationaliser l’accès aux aides financières
Autre pilier de la loi de 2005 : la création de la prestation de compensation du handicap (PCH). Cette aide financière, instaurée pour couvrir les surcoûts humains et matériels liés au handicap, reste un dispositif complexe. En 2022, la durée maximale d’attribution de tous les éléments de la PCH a été étendue à 10 ans, contre 5 ou 3 ans précédemment, permettant d’atteindre 429 000 bénéficiaires. En 2023, un soutien à l’autonomie a été ajouté en cas de difficultés psychiques, mentales, compréhension, concentration, mémoire, autisme, etc.
En dépit de ces progrès, les disparités d’attribution par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) cristallisent le mécontentement des demandeurs. Par ailleurs, les longs délais de traitement, de 4 à 6 mois en moyenne début 2024, continuent de dissuader des bénéficiaires potentiels.
Laurent Clause
Sébastien Peytavie : "Pas sans nous !"
Scolarité, emploi ou accessibilité dans les bâtiments neufs : tous ces domaines ont fait l’objet d’avancées considérables mais des inégalités persistent selon le type de handicap, a indiqué le 4 février 2025 Sébastien Peytavie, député écologiste et social de Dordogne, lors du séminaire des réseaux mutualistes.
Membre de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée nationale et rapporteur d’une mission d’évaluation sur la loi handicap, il entend « donner la parole aux personnes concernées ».
Pour témoigner et enrichir la réflexion de cette mission d'évaluation : https://riensansnous.fr/